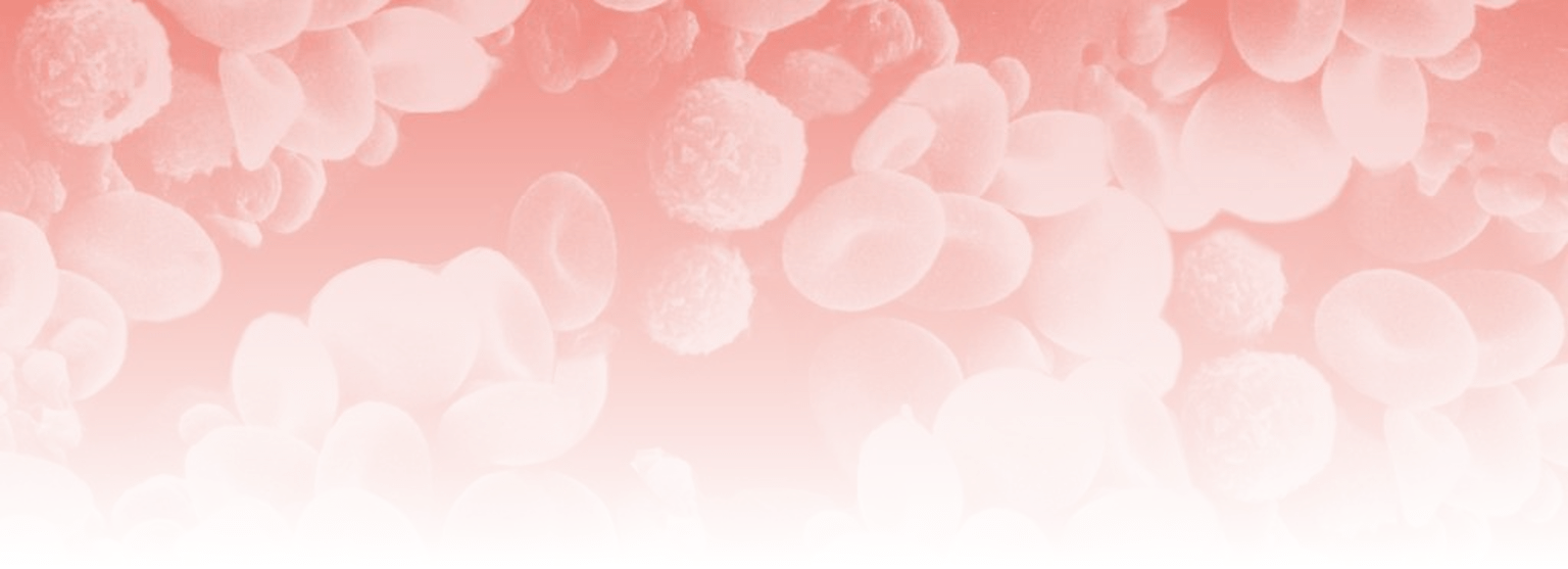
Journée Internationale des Maladies Rares 2025

28 février 2025
Nous soutenons la Journée Internationale des Maladies Rares (JIMR) 2025 !
Depuis 2008, le dernier jour du mois de février est dédié aux maladies rares afin de sensibiliser le public à ces maladies qui touchent moins de 1 personne sur 2 000 chacune, mais qui, du fait de leur nombre élevé (près de 7 000 !), concernent au total plus de 300 millions de personnes dans le monde sans compter les aidants !
Cette campagne est coordonnée par EURORDIS-Rare Diseases Europe au niveau international. Cette année, le slogan est « More than you can imagine ».
Les maladies rares chez Santé Active Edition ─ Synergy Pharm
Prenant part à cette campagne, nous avons publié plusieurs posts sur notre page LinkedIn ces dernières semaines pour mettre en lumière les maladies rares et des problématiques liées à ce domaine à partir de projets auxquels notre équipe de rédaction médicale et scientifique a apporté son support ces derniers mois.
Syndrome nail patella
Le syndrome Nail-Patella (NPS) ou ostéo-onychodysplasie est une maladie génétique multisystémique rare qui est associée à une douleur chronique très souvent difficile à soulager par les traitements analgésiques classiques. Les patients atteints de cette maladie peuvent alors être pris en charge en soins palliatifs afin de trouver des solutions plus adaptées pour améliorer leur qualité de vie.
Sur la base de son expérience clinique et de précédents travaux de recherche, le Pr Céline Gréco (cheffe du service Médecine de la douleur et palliative à l’hôpital Necker-Enfants malades, Paris, France) a proposé à des patients atteints de NPS avec douleur chronique persistante un traitement oral à base de cannabidiol synthétique (CBD, fabriqué à partir du D-Limonène des écorces d’oranges et donc dépourvu totalement de THC) pendant 3 mois. Cette molécule peut agir directement sur les neurotransmetteurs de la douleur dont l’expression est dérégulée par la mutation LMX1b en cause dans le NPS.
Les données de vie réelle d’un groupe de 32 patients ont pu être collectées dans le service du Pr Gréco et analysées afin d’évaluer l’efficacité de ce nouveau traitement sans effet psychoactif. Les résultats de cette étude en pratique clinique courante ont été publiés récemment dans le journal Scientific Reports (publié par le groupe Springer Nature). Dans cet article, les auteurs ont montré une réduction significative de l’intensité de la douleur chez les patients avec NPS traités par CBD médical (dose médiane de 900 mg/jour), ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie et d’autres symptômes associés au NPS chez la majorité des participants. Dans l’ensemble, ce traitement a été bien toléré.
Le traitement par CBD médical est donc très prometteur pour la prise en charge de la douleur chronique chez les patients avec NPS et peut constituer une alternative aux analgésiques conventionnels. D’autres patients avec des douleurs chroniques d’origine neurologique pourraient aussi bénéficier de ce traitement. Les recherches sur le CBD médical doivent être poursuivies pour mieux comprendre les mécanismes impliqués dans ses effets sur la douleur et son impact neuropsychologique chez les patients traités.
Maladies héréditaires du métabolisme (MHM)
Les maladies héréditaires du métabolisme (MHM), aussi appelées erreurs innées du métabolisme (EIM), résultent du déficit d’une enzyme ou d’un transporteur impliqués dans de nombreuses voies métaboliques. Les MHM englobent plus de 1 000 maladies d’origine génétique ! Elles sont classées en trois groupes selon une physiopathologie commune : maladies par intoxication, maladies par déficit énergétique, et maladies des molécules complexes.
Les patients présentant une MHM sont suivis par des experts hautement spécialisés dans un centre de référence ou un centre de compétence de la Filière Santé Maladies Rares (FSMR) G2M. Cependant, ces patients peuvent avoir besoin de soins en urgence, et les professionnels de santé qui les examinent en urgence ne connaissent pas forcément toutes ces maladies rares. Un groupe de travail pluridisciplinaire de la FSMR G2M a développé plus de 50 protocoles courts et standardisés axés sur une maladie, un groupe de maladies ou un symptôme afin de fournir aux professionnels de santé des conseils pratiques pour la prise en charge immédiate des patients atteints de MHM nécessitant des soins d’urgence. Certains protocoles ont été élaborés en collaboration avec des spécialistes d’autres FSMR (MHEMO, Cardiogen, Filfoie et FIRENDO), et tous les protocoles ont été systématiquement revus par des médecins de services d’urgence et d’unités de soins intensifs, des anesthésistes, des médecins généralistes et des associations de patients.
Tous les protocoles d’urgence sont en accès libre, en français et en anglais, sur la page URGENCES du site Internet de la filière G2M. Un article décrivant comment ces précieux outils ont été développés a été publié dans Molecular Genetics and Metabolism (MGM): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39305737/
Maladie de Gaucher
La maladie de Gaucher (MG) est une MHM causée par un déficit dans l’activité de l’enzyme lysosomale glucocérébrosidase, entraînant l’accumulation de « cellules de Gaucher » dans des organes tels que le foie, la rate et la moelle osseuse. La MG est une maladie multisystémique hétérogène ; trois formes cliniques ont été décrites, la MG de type 1 (MG1) étant la plus courante. La MG1 associe organomégalie, cytopénie et atteinte osseuse à des degrés variables. Les manifestations osseuses de la MG1 sont une cause majeure de douleur et d’invalidité ; elles nécessitent une surveillance régulière.
Le MG1 est l’une des rares maladies rares pour lesquelles des traitements efficaces sont disponibles. La vélaglucérase alpha, une enzyme substitutive recombinante, est l’un des principaux traitements de la MG1. L’analyse des données provenant de registres de patients nationaux et internationaux a fourni des preuves de l’efficacité à long terme de la vélaglucérase alpha dans le traitement des manifestations viscérales et hématologiques de la MG1. Cependant, en raison de la complexité des manifestations osseuses, l’effet de ce traitement sur l’évolution de l’atteinte osseuse de la MG1 en vie réelle est moins connu.
Pour combler cette lacune, le Dr Nadia Belmatoug (Centre de Référence des Maladies Lysosomales, Hôpital Beaujon, Paris, France) et ses collègues ayant une expertise dans la prise en charge des patients atteints de MG et travaillant dans d’autres hôpitaux français ont utilisé des données d’imagerie par résonance magnétique (IRM) collectées dans la pratique clinique lors de suivi de l’atteinte osseuse de 20 patients atteints de MG1 traités par vélaglucérase alfa. Les IRM ont été analysées en aveugle de manière centralisée par un radiologue expert afin de fournir à la fois une mesure semi-quantitative de l’atteinte osseuse (score Bone Marrow Burden, BMB) et une évaluation qualitative de la stabilité, de l’amélioration ou de l’aggravation de l’atteinte osseuse. Les résultats ont fourni des preuves de l’efficacité à long terme, en vie réelle, de ce traitement sur les manifestations osseuses de la MG1 : amélioration des paramètres observés en IRM au cours des cinq premières années de traitement, et atteinte osseuse stable chez les patients traités depuis plus longtemps. L’étude a également fourni des informations précieuses sur les protocoles actuels de surveillance des patients atteints de MG1 en France, et a suggéré qu’une évaluation qualitative simplifiée pourrait être suffisante dans la pratique clinique pour surveiller la progression de l’atteinte osseuse et la réponse au traitement lorsque qu’une évaluation par IRM ne peut pas être effectuée par des radiologues expérimentés en MG1.
Les résultats de cette étude (EIROS) ont été publiés dans le Journal of Clinical Medicine : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38792468/
Maladies rares : la recherche médicale continue
En 2024 notre équipe de rédaction médicale et scientifique a également accompagné plusieurs clients en amont des publications, dans la rédaction de dossiers réglementaires et cliniques liés aux maladies rares : deux protocoles de recherche et les documents qui les accompagnent, et deux rapports d’étude clinique.
Actuellement, un traitement est disponible pour seulement 5% des maladies rares !
La recherche médicale est dynamique mais le faible nombre de patients touchés par une même maladie rare et le grand nombre de maladies rares (près de 7 000 !) rendent difficile l’acquisition de connaissances sur ces maladies et le développement de traitements dédiés. Afin de faciliter et d’accélérer le développement de traitements, le projet européen INVENTS (Innovative designs, extrapolation, simulation methods and evidence-tools for rare diseases addressing regulatory needs), financé par le programme Horizon Europe de la Commission Européenne et coordonné par l’INSERM, a pour objectif d’élaborer de nouvelles méthodes d’évaluation spécifiquement adaptées à ces contraintes.
Implication des patients dans la recherche sur les maladies rares
Les patients et associations de patients sont de plus en plus impliqués dans la recherche, notamment dans le domaine des maladies rares. Leur expérience et leur vécu sont précieux ! D’ailleurs, nous soulignions récemment l’évolution de la terminologie dans la dernière mise à jour de la Déclaration d’Helsinki qui énonce des principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des participants humains. Le remplacement de « êtres humains », « personnes impliquées » ou « patients » par « participants » souligne l’engagement des patients ou volontaires en bonne santé en tant que partenaires de la recherche.
De ce fait, les patients peuvent également être impliqués dans la rédaction d’articles scientifiques et être ainsi auteurs de publications ! Les recommandations de bonnes pratiques comme celles de l’ICMJE y sont favorables, et Angélique SAUVESTRE VARELA, présidente de l’association Debra France et maman d’une petite fille atteinte d’épidermolyse bulleuse, fait partie des auteurs d’un article auquel notre équipe de rédaction médicale et scientifique a contribué : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36545933/.
- Retrouvez plus d’informations sur des maladies rares sur lesquelles nous avons travaillé (microsomie craniofaciale, mucoviscidose, épidermolyses bulleuses héréditaires, maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle épinière) et les défis liés à ces maladies dans nos précédentes actualités :
- Le nouveau plan national maladies rares (PNMR4), dont nous vous parlions dans notre actualité « Journée Internationale des Maladies Rares 2024 », a été officiellement lancé le 25 février 2025 par Madame Catherine Vautrin, Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Monsieur Philippe Baptiste, Ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et Monsieur Yannick Neuder, Ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins. Intitulé « Des territoires vers l’Europe », il couvre la période 2025-2030.
- Le rapport de la Banque Nationale de Données Maladies Rares (BNDMR) et le fichier Excel dans lesquels figure le nombre de cas par maladie rare recensés dans la BNDMR (si plus de 10 patients sont concernés par une maladie) ont été mis à jour en décembre 2024.
- De plus, le cahier Orphanet « Vivre avec une maladie rare en France » qui rassemble les aides et prestations pour les personnes atteintes de maladies rares et leurs proches (aidants familiaux/proches aidants) a également été mis à jour en décembre 2024.